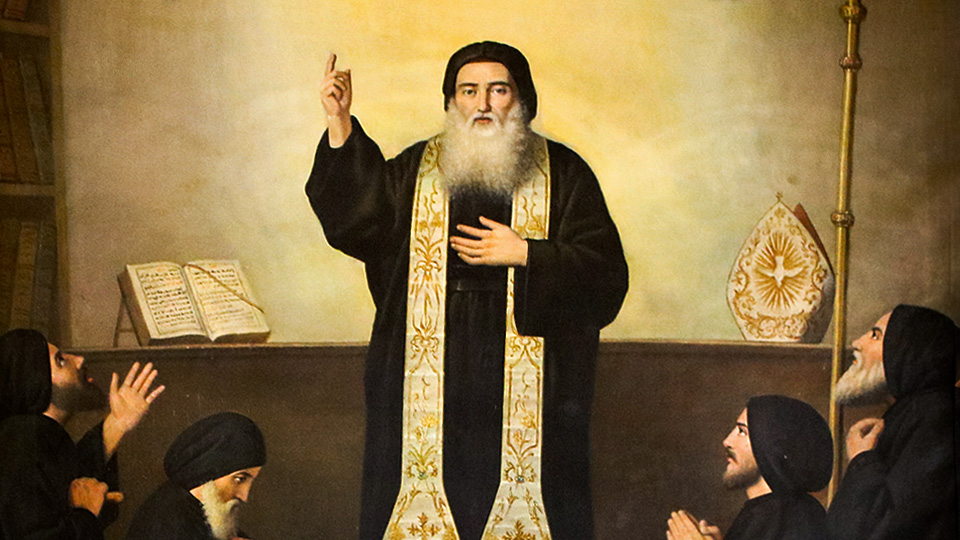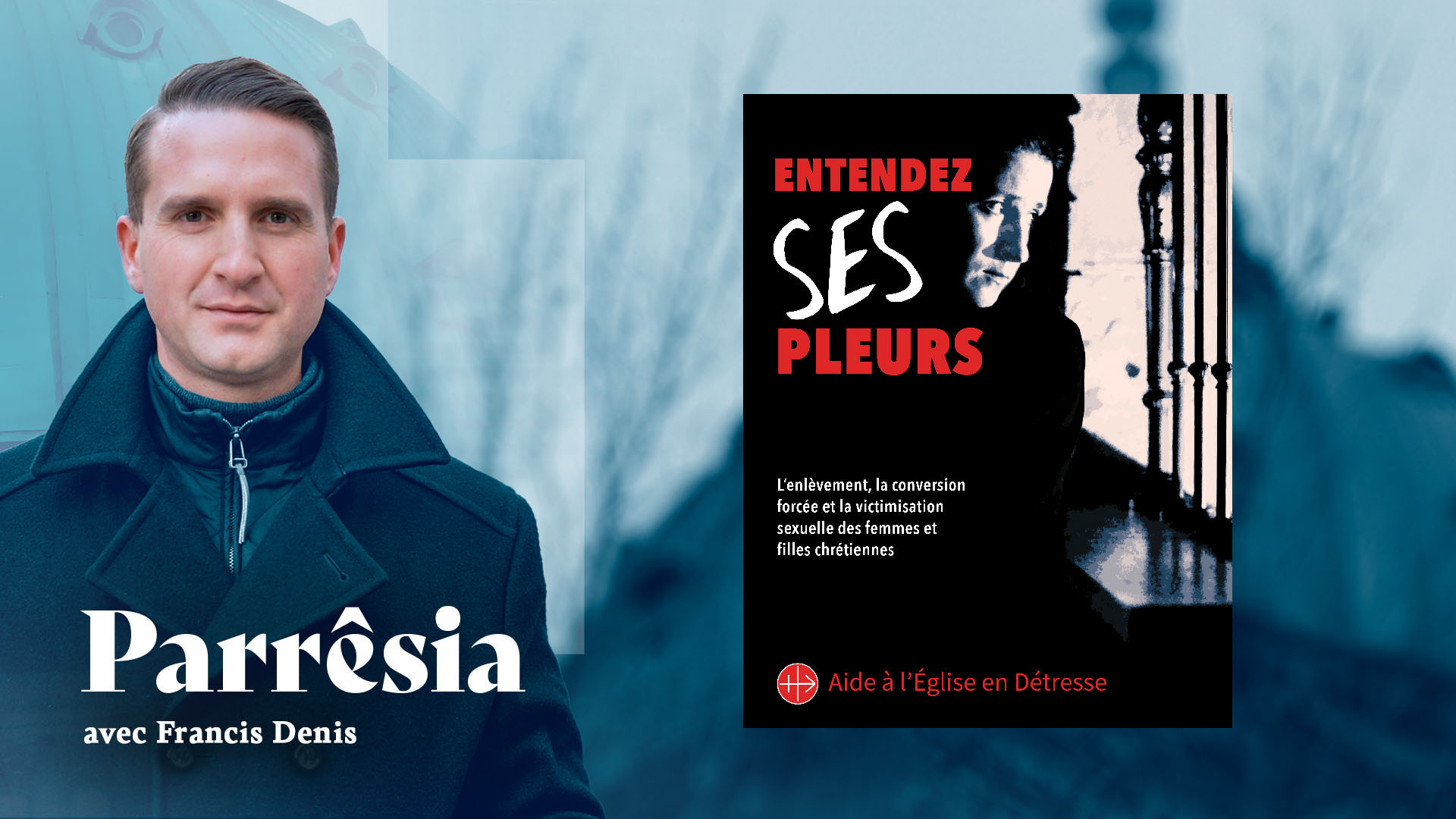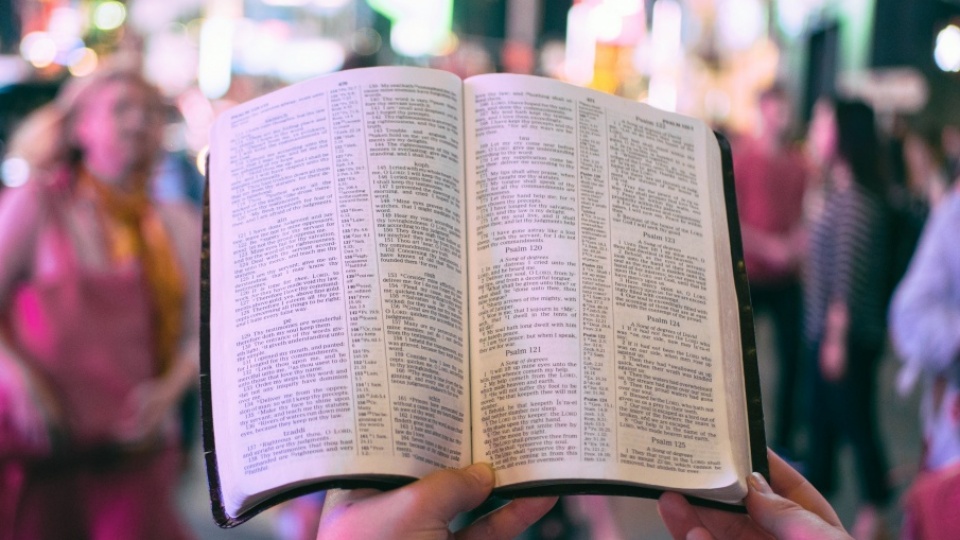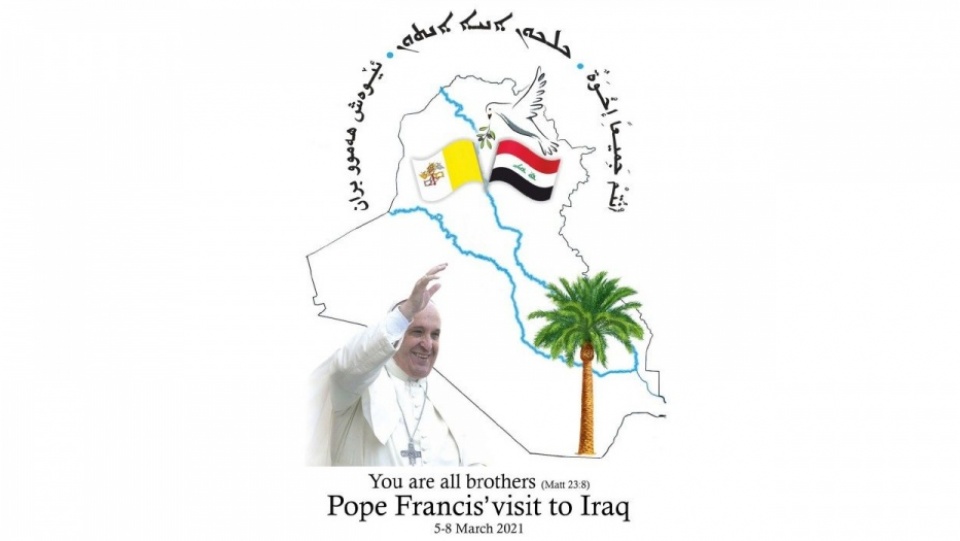Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima au Portugal. Crédit photo : Aline Haddad.
Lisez la première partie de cet article qui couvre le pèlerinage qui a débuté en France à Notre-Dame de Lourdes et a traversé le sanctuaire de Saint Jacques de Compostelle en Espagne.
En route vers le Portugal
L’enthousiasme est resté toujours haut durant tout le pèlerinage, car ce que je vivais, ce que j’ai découvert par après et ce que tout le groupe a vécu, était plus que spirituel.
De passage par la ville de Porto, classée patrimoine mondial de l’Unesco; une messe aussi émouvante que les autres à la chapelle de Notre Dame de la Bonne Heure qui veille sur nous à l’heure de notre naissance et celle de notre départ vers la vie éternelle. De retour au Canada et en faisant une petite recherche, j’ai compris que ce qu’on a vu n’est qu’un petit échantillon de la beauté des églises de Porto.
La visite de la ville et quelques quartiers essentiels, ainsi que le quai et une manufacture de vin Porto pour compléter la journée, nous laissant émerveillés par les couleurs de cette ville merveilleuse.
En allant vers Fatima, notre guide nous a proposé un arrêt à Aveiro, la Venise du Portugal, où on a visité l’église Santa Casa de Misericordia, et où on a mangé et passé un peu de temps libre avant de se rendre à notre troisième sanctuaire de notre pèlerinage.
Sur le chemin, notre guide Ana nous a raconté l’histoire de Notre-Dame de Fatima et les trois petits bergers, ce qui va nous faire vivre notre première expérience émouvante lors de la messe à la chapelle de Notre-Dame des Douleurs, une des différentes chapelles à Fatima. Lors de la messe, le Père Blanchette nous demande de se tourner tous au moment des intentions. Et à notre grande surprise, on aperçoit les vitraux qui résument toute l’histoire. Ce qui rend le moment encore plus fort est la demande du père de faire notre intention pour une personne spécifique tout en contemplant le soleil tournant avec le bras levé. Quelle expérience inoubliable !

Père Jean-Luc Blanchette célébrant la messe à la chapelle de Notre-Dame des douleurs, à Fatima. Crédit photo : Aline Haddad.
Chaque soir à Fatima, beau temps et mauvais temps, on participait à la prière dans la petite chapelle, la Capelinha où Notre-Dame est apparue aux trois enfants, et à la procession mariale qui regroupe des dizaines de milliers de pèlerins de partout au monde.
La deuxième messe à Fatima fut à la chapelle des Anges de la Paix. Les messes représentaient plus qu’une liturgie surtout avec père Blanchette qui, par ses demandes de prière la transformait en une célébration commune qui faisait vivre chaque pèlerine et pèlerin du groupe un moment marquant. Durant cette messe des intentions anonymes instantanées ont fortifié la demande de prière, car ça a été fait en groupe.
Ce qui me marque aussi est la prière jubilaire de consécration à Notre-Dame de Fatima à l’occasion du Jubilé 2025. Ainsi que la petite excursion à l’itinéraire du pèlerin « Aljustrel Et Valinhos », comme pèlerins d’espérance, on a prié le chemin de croix avant de se rendre à l’endroit où l’Ange de la Paix s’est apparu aux trois enfants en passant par des champs d’oliviers, havre de paix et de solitude. Suivie par une visite guidée vers les maisons où ont habité Lucie, François et Jacinthe.
À Fatima, nous avons visité le musée, ainsi que la basilique et les différentes églises dont l’église de la Très Sainte Trinité, quatrième plus grande église catholique au monde pouvant accueillir presque 9000 fidèles, devant laquelle une statue du Saint Jean Paul II.
Petites excursions de Fatima

Chemin de croix, une partie du chemin du pèlerin « Aljustrel Et Valinhos » pas loin des maisons des trois bergers de Fatima et de l’endroit de l’apparition de l’ange. Crédit photo : Aline Haddad.
Tomar est une des villes que je rêvais de visiter un jour. Une courte visite de cet endroit plein de richesse artistique et culturelle avant de se diriger vers Batalha. Le monastère de Santa Maria de Vitoria à Batalha est classé patrimoine mondial de l’UNESCO et résume deux siècles de construction pour commémorer la Victoire des portuguais sur les Castillans lors de la bataille d’Aljubarrota en 1385.
En Direction Vers Lisbonne
Avant de quitter Fatima, une messe à l’église de San Arnaldo Janssen a été célébrée pour se diriger après vers Lisbonne. Notre dernière étape du pèlerinage. En route, la suggestion de notre guide Ana pour visiter Obidos, qui veut dire un lieu élevé, était géniale. Malgré la pluie, on a été émerveillé par cette petite cité médiévale et ses ruelles étroites et bien décorées.
En temps libre à notre arrivée à Lisbonne, Mireille et moi avons profité d’une petite marche à côté de l’hôtel et la visite de la tour Vasco de Gama, haute de 145 mètres, où on a contemplé, depuis la plateforme d’observation, Lisbonne et le pont Vasco da Gama, le plus long pont en Europe qui traverse le Tage sur 17 km.
Notre dernière journée du pèlerinage

Le monastère de Santa Maria de Vitoria à Batalha est classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Crédit photo : Aline Haddad.
Notre voyage approche à sa fin. C’est notre dernière journée de ce pèlerinage plein d’émotions, de rêve et de gratitude. Un jour trop chargé qui commence par la visite du monastère des Hiéronymites ou le monastère saint Jérôme à Lisbonne.
Au retour vers le bus, Claudio, notre chauffeur, nous surprend en nous offrant des pasteis de nata fraîches et encore chaudes. Un délice succulent comme je n’en avais jamais goûté. C’était étrange : elles semblaient avoir le goût de l’ambiance, du groupe, du pèlerinage lui-même… Moi qui n’aimais pas ce dessert portugais auparavant.
Visite à pied de la ville de Lisbonne ainsi que les ruelles à côté de la porte de la Ville et la place du commerce au bord de l’eau. Repas rapide, au pouce, pour aller rejoindre le groupe et se diriger vers l’ascenseur qui va nous faciliter le trajet pour aller à pied à l’église de Saint Antoine de Lisbonne, comme les portuguais l’appellent Saint Antoine de Padoue. Quelle belle messe avec Père Blanchette et quelle surprise de pouvoir vénérer les reliques de Saint Antoine. De plus, nous avons visité l’endroit où il est né, ainsi que la cathédrale où il a été baptisé. Je n’en revient pas avoir vécu tout ça.
Nous avons terminé la journée par un tour à pied avec Ana dans le quartier d’alfama avec ses escaliers, sa particularité et son histoire. Je suis sûre que ce qu’on a vu n’est qu’un petit exemple de ce que cette belle ville, cache au monde. Nous avons eu notre soirée d’adieu à l’hôtel qui a été pleine d’émotions et d’émerveillements de ce qu’on vient de vivre ces 15 jours.
Pendant tout le pèlerinage, que ce soit en France, en Espagne ou au Portugal, Spiritours a pris le soin de nous héberger dans des hôtels confortables et accueillants. En plus les repas offerts matin et soir étaient généreux et succulents représentant souvent des mets des régions qu’on visitait.
Cette année encore Spiritours avec Sel et Lumière Média vous propose un pèlerinage en Grèce, riche en découvertes, en spiritualité et en histoire. Je vous conseille de visiter et de réserver tôt car les places s’envolent comme du pain chaud.