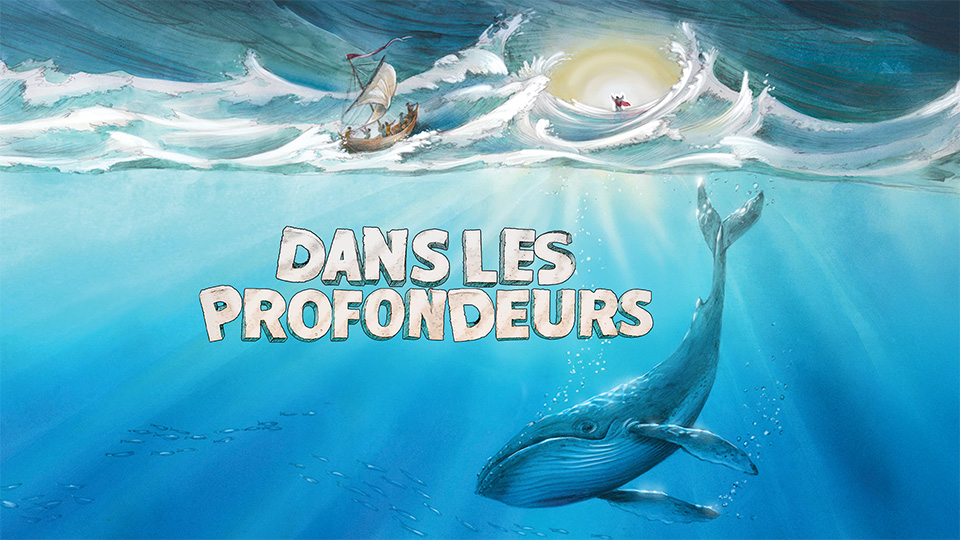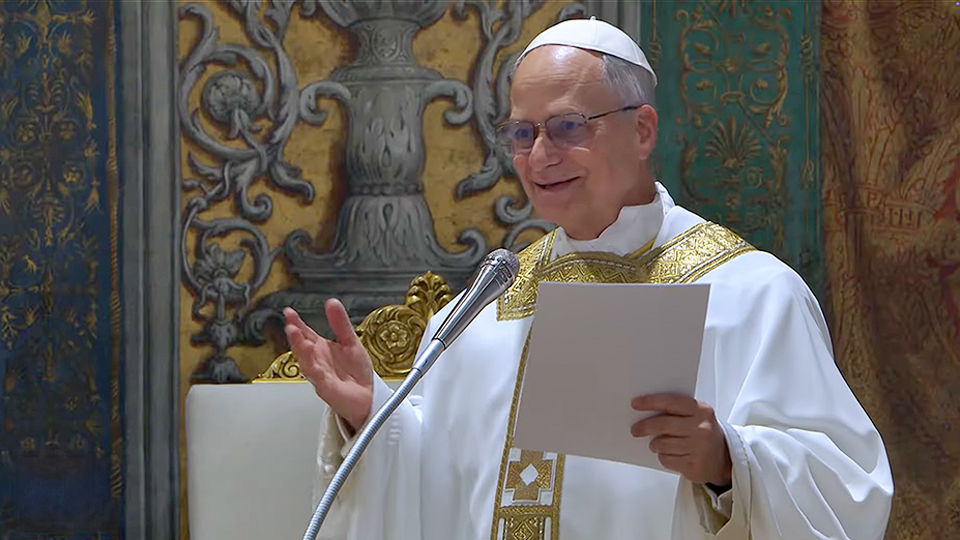Les jeunes catholiques célibataires sont des membres précieux de l’Église catholique. Ils et elles s’engagent de multiples façons : comme lectrices et lecteurs, huissiers, ministres extraordinaires de la Sainte Communion, choristes, bénévoles pour l’entretien, et bien d’autres services encore. Même lorsqu’ils ne sont pas activement engagé.es dans leur communauté, ils portent en eux de riches talents et des qualités précieuses à offrir à l’Église ainsi qu’à leur futur époux ou future épouse.
Cette année, nous invitons tous les catholiques et leurs proches qui sont à la recherche d’un amour enraciné dans la foi, à se joindre à nous pour la neuvaine « À la recherche d’un cœur de saint : une neuvaine à saint Valentin » ! Cette neuvaine vous aidera à grandir dans l’espérance et la confiance en Dieu, à réfléchir à la vocation du mariage et à demander l’intercession des saints qui incarnent un amour fidèle et fécond.
Vous êtes faits pour aimer. Prions pour cela !
À partir du 5 février, nous publierons quotidiennement des vidéos de prière sur Facebook, Instagram, YouTube, et X, accompagnées de courtes réflexions dans les légendes. La neuvaine explorera les thèmes de la patience, du courage, de la chasteté et de la guérison. Nous publierons également plusieurs nouveaux articles de blogue pour vous accompagner dans votre cheminement de prière.
En cette fête de Saint-Valentin, nous élevons nos prières pour les jeunes catholiques célibataires de notre entourage qui désirent trouver sa deuxième moitié dans la sainteté ; puissent-ils découvrir et vivre fidèlement la sainte volonté de Dieu pour eux.
Vous souhaitez partager cette neuvaine avec une ou un ami.e ? Envoyez-lui cet article.